Institutions
Thierry Chopin,
Cédric Musso
-
Versions disponibles :
FR
Thierry Chopin
Cédric Musso
I - La répartition des eurodéputés français au sein des instances du Parlement européen
Le Parlement européen combinant les logiques majoritaire et proportionnelle, les groupes politiques y jouent un rôle majeur, plus particulièrement le groupe politique majoritaire depuis 1999, le PPE [2]. La mise à disposition de moyens techniques (collaborateurs, secrétariat, salle de réunion, budget pour publications, traductions, etc.) ainsi que le droit de parole et d'initiative politique sont en effet proportionnels à la taille du groupe.
Il en est de même de l'accession aux postes de responsabilités (vice-présidences du Parlement européen et questure de l'Assemblée, présidences et vice-présidences des commissions et délégations, rapporteurs).
Les groupes politiques décident ainsi des postes-clés tant au niveau de la présidence du Parlement européen (Vice-président, questeur, etc...) qu'au niveau des commissions parlementaires (présidence, rapport, interventions)...
En conséquence, l'influence de la France se mesure à la répartition de ses eurodéputés au sein des divers groupes, à la manière dont ils auront su intégrer les groupes numériquement importants en vue d'obtenir le maximum de postes clés au sein des commissions parlementaires.
A - Les groupes politiques
La mandature 1999-2004 comprenait sept groupes politiques outre le rassemblement des non-inscrits, soit huit groupes. La France se singularisait par la dispersion de ces 87 députés parmi ces huit groupes et par le fait que plus d'un député français sur deux était membre de l'un des quatre groupes les moins influents ou siégeait parmi les non inscrits.
Cette volatilité ne permettait pas à la France de constituer une masse critique à la différence de l'Allemagne dont les 99 députés se répartissaient entre trois groupes, dont les deux plus importants [3].
Avec la 6ème législature, la France a cédé à l'Italie son triste record relatif à la dispersion de ses eurodéputés dans tous les groupes politiques du Parlement européen. Il convient en effet de relever une nouvelle concentration des eurodéputés français dans les groupes numériquement importants, deux eurodéputés français sur trois appartenant désormais à l'un des groupes les plus influents.
Représentation allemande, française et britannique au sein des groupes politiques du Parlement européen durant la 6ème législature
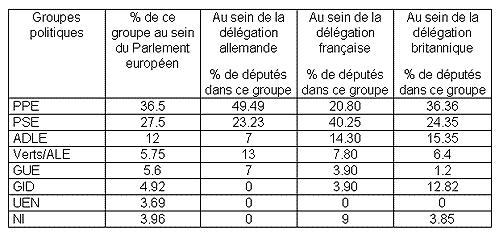
Cette nouvelle concentration dans les groupes les plus influents a permis à la France de maintenir, avec 2 vice-présidents, le niveau de sa représentation au sein du bureau du Parlement européen malgré l'arrivée au sein de celui-ci de représentants des nouveaux Etats membres. Loin de se réduire à des postes symboliques, ces vice-présidences permettent à la France d'exercer une influence sur des questions clés.
B - Les commissions parlementaires
1 - La répartition des eurodéputés français dans les différentes commissions
Durant la mandature précédente, les eurodéputés français étaient fortement attirés par les commissions en charge de secteurs sur lesquels l'impact du travail du Parlement européen était limité (en particulier les commissions principalement chargées du suivi de la coopération intergouvernementale comme par exemple la commission des affaires étrangères, des droits de l'homme, de la sécurité commune et de la politique de défense). En revanche, les six commissions dites « législatives », en particulier les commissions à vocation économique, dans lesquelles le Parlement européen a progressivement acquis un pouvoir de codécision avec le Conseil des ministres, étaient relativement délaissées par les Français [4].
Sous la sixième législature, l'organisation sectorielle des commissions a été revue et leur nombre a été légèrement accru (21 contre 17, le nombre des commissions à vocation législative et économique passant quant à lui de 6 à 8). La représentation française au sein des commissions économiques et législatives est beaucoup plus importante que par le passé allant même jusqu'à concurrencer celle des eurodéputés britanniques très attachés à être fortement présents au sein de ces commissions.
Représentation allemande française et britannique au sein des huit commissions à vocation législative et économique dans l'actuelle mandature
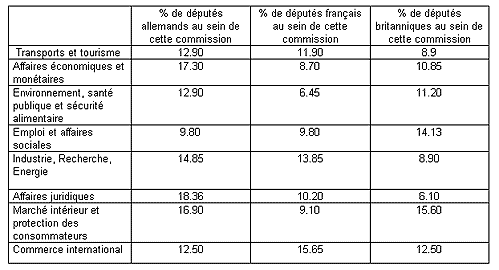
2 - Les présidences
Si les pouvoirs inhérents à la fonction de présidence de commission sont minimes, un président de commission ne pouvant décider en lieu et place des membres de celle-ci, la portée symbolique de ce poste ne saurait être sous-estimée s'agissant de l'influence que peut exercer un Etat membre.
Durant la 5ème législature, la France n'eut que 2 présidences sur les 17 commissions parlementaires (contre 3 pour l'Allemagne et 3 pour le Royaume-Uni). Ce maigre bilan quantitatif n'était pas compensé d'un point de vue qualitatif puisque les commissions présidées par des eurodéputés français (Culture et Agriculture) ne figurent pas dans la liste précitée des commissions les plus influentes.
Sous la 6ème législature, la France compte 4 présidences de commission - affaires économiques et monétaires; agriculture; pêche; liberté, justice et sécurité - (contre 3 pour l'Allemagne, l'Espagne et l'Italie et 2 pour le Royaume-Uni) sur les 21 que comprend le nouvel organigramme du Parlement européen. Outre le progrès quantitatif, les commissions présidées par des Français sont plus influentes que par le passé (surtout pour ce qui concerne la commission des affaires économiques et monétaires).
3 - Les coordinateurs
Chargés de suivre et d'orienter les décisions dans les commissions parlementaires au nom des groupes qui les ont désignés, les coordinateurs exercent une influence non négligeable sur les travaux du Parlement européen.
Le bilan français de cette nouvelle législature montre une progression dans ce domaine en comparaison de la précédente.
Aucun Français n'est coordinateur pour le groupe PPE ( contre 6 Allemands, 5 Britanniques, 4 Espagnols) contre un demi poste (partagé avec un Néerlandais) sous la précédente mandature.
Deux Français seulement sont coordinateurs pour le groupe PSE (contre 6 Allemands, 3 Espagnols, 2 Britanniques), soit le même nombre que sous la précédente mandature.
Un progrès notable doit être constaté au sein du groupe ADLE qui comprend 3 coordinateurs français dans les commissions suivantes : développement régional; emploi et affaires sociales; développement. Sous l'ancienne mandature, le groupe des libéraux ne comptait aucun coordinateur français.
D'un point de vue institutionnel, l'influence française au sein du Parlement est donc aujourd'hui bien plus importante qu'elle ne l'était à la veille des élections européennes de juin 2004. Les leçons énoncées lors de la campagne (nécessaire concentration dans les groupes politiques majoritaires, meilleure représentation au sein des commissions parlementaires) ont été tirées.
II - L'activité des eurodéputés français : une productivité accrue
La précédente législature du Parlement européen mettait en évidence, à quelques exceptions près, une faiblesse relative de l'activité des eurodéputés français. Si, depuis un an, l'absentéisme des députés français, qui cumulent souvent plusieurs mandats, semble être à nouveau la règle, le bilan en terme de "productivité" est plus positif.
A - Une constante : l'absentéisme aux séances plénières
Le recensement 2005 d'"europarliament.net" permet de constater que le taux de présence en séance plénière de la délégation française atteint 83.17%. Comparé à la moyenne de la mandature précédente, soit 79.22%, force est de constater un progrès même si la France est toujours en dessous de la moyenne européenne, soit 87.36% [5].
En effet, lorsque l'on compare le taux de présence des eurodéputés français avec celui des 24 autres Etats membres, il ressort que la France est au 23ème rang sur 25 loin derrière les délégations chypriote et autrichienne qui affichent respectivement des taux de 97.16 et 95.04%.
Au niveau du classement individuel, le constat est également négatif. Si l'eurodéputé le plus assidu est français, plus précisément française (Françoise GROSSETETE avec un taux de présence de 100%), deux eurodéputés français figurent dans le groupe des cinq élus les plus absents.
L'absentéisme des eurodéputés français est d'autant plus dommageable que le vote au Parlement européen est strictement personnel, i.e. qu'il n'est pas possible de donner procuration à un autre parlementaire européen.
Au-delà de la seule présence, l'activité des eurodéputés doit également être mesurée au regard des critères de productivité.
B - La "productivité" des eurodéputés français: un premier bilan positif
1 - Le nombre d'interventions en séances plénières
Le nombre d'interventions des eurodéputés français durant les six premiers mois de l'année 2003 avait été recensé. Il en était ressorti que l'activité des eurodéputés français avec 239 interventions était moindre que celle des eurodéputés allemands (303) et surtout britanniques (309).
La première année de la 6ème législature accentue cette tendance puisque le nombre d'interventions de la part des députés français (547) est largement inférieur à celui des députés britanniques (857) et allemands (881).
Il est évident qu'une présence silencieuse a peu d'effets sur l'influence que peut exercer un député européen.
2 - La publication de rapports parlementaires
Une étude réalisée en mars 2004 par le MEDEF [6] révélait que de 1999 à fin 2003, les 31 députés néerlandais avaient rédigé 107 rapports, les 99 députés allemands 299, les 87 députés français 119. Le taux d'activité était donc au terme de la 5ème législature de 3,45 rapports pour un député néerlandais, 3,01 rapports pour un député allemand, 2,73 rapports pour un député britannique contre seulement 1,36 pour un député français.
Une analyse des travaux parlementaires de la première année de la 6ème législature permet de constater que les 27 députés néerlandais ont rédigé 13 rapports, les 99 députés allemands 32 rapports, les 78 députés britanniques 26 alors que les 78 députés français en ont rédigé 42. Le taux d'activité est donc de 0.48 rapport pour un député néerlandais, 0.3 pour un Allemand, 0.3 pour un Britannique et 0.53 pour un Français.
La productivité des députés français a donc considérablement augmenté au point de dépasser celle des députés européens traditionnellement les plus actifs. Ce nouvel activisme des eurodéputés français s'explique largement par le poids nouveau qu'ils représentent dans les groupes politiques influents et par conséquent par leur capacité à se voir confier des missions pour orienter les travaux du Parlement.
Conclusion
En comparaison du constat qui pouvait être effectué de la faiblesse de la présence française au Parlement européen entre 1999 et 2004, il convient, un an après les élections de juin 2004, de souligner que des progrès sensibles ont été réalisés en matière d'organisation et de structuration politique comme d'implication des eurodéputés français au Parlement européen. Si certaines faiblesses structurelles ont pu être soulignées lors de la campagne de 2004, elles ont été dans une certaine mesure corrigées dès l'entame de cette sixième législature. Des progrès peuvent naturellement encore être accomplis, ce qui exige sans doute, et à titre d'exemple, des réformes nécessaires en matière d'interdiction de cumul des mandats. Quoi qu'il en soit, mieux organisés et structurés politiquement au sein du Parlement européen, plus impliqués et plus actifs, les 78 députés européens français ont pris conscience de l'importance du Parlement européen, de ses pouvoirs sans cesse croissants et des décisions qui y sont prises pour les citoyens.
[1] Voir Yves Bertoncini et Thierry Chopin, Le Parlement européen : un défi pour l'influence française, note de la Fondation Robert Schuman, n°21, avril 2004.
[2] PPE-DE Groupe du Parti populaire européen (Démocrates-chrétiens) et des Démocrates européens; PSE Groupe socialiste au Parlement européen ; ALDE Groupe Alliance des démocrates et des libéraux pour l'Europe; Verts/ALE Groupe des Verts/Alliance libre européenne GUE/NGL; Groupe confédéral de la Gauche unitaire européenne/Gauche verte nordique; IND/DEM Groupe Indépendance/Démocratie UEN Groupe Union pour l'Europe des Nations; NI Non-inscrits
[3] Représentation allemande, française et britannique au sein des groupes politiques du Parlement européen durant la 5ème législature

[4] Représentation allemande française et britannique au sein des six commissions à vocations économiques dans la précédente mandature:

[5] http://www.europarliament.net/server5c7e.html
[6] Memorandum MEDEF Europe 2004, mars 2004.
Directeur de la publication : Pascale Joannin
Pour aller plus loin
Démocratie et citoyenneté
Blandine Chelini-Pont
—
5 mai 2025
Démocratie et citoyenneté
Birgit Holzer
—
28 avril 2025
Climat et énergie
Valérie Plagnol
—
22 avril 2025
Liberté, sécurité, justice
Jean Mafart
—
14 avril 2025

La Lettre
Schuman
L'actualité européenne de la semaine
Unique en son genre, avec ses 200 000 abonnées et ses éditions en 6 langues (français, anglais, allemand, espagnol, polonais et ukrainien), elle apporte jusqu'à vous, depuis 15 ans, un condensé de l'actualité européenne, plus nécessaire aujourd'hui que jamais
Versions :




