Actualité
Corinne Deloy,
Fondation Robert Schuman
-

Versions disponibles :
FR
EN
Corinne Deloy
Fondation Robert Schuman
Les élections législatives qui se tiendront le 15 septembre prochain en Macédoine constituent la dernière étape de l'application de l'accord de paix signé par les principaux partis macédoniens, le 13 août 2001, sur les bords du lac Ohrid. A la demande de l'Union européenne et de l'OTAN dans le but de régulariser la situation politique macédonienne, le scrutin, initialement prévu en novembre, se tiendra donc deux mois avant la fin normale du mandat de l'actuelle législature. Huit cents observateurs européens suivront le déroulement des quatrièmes élections parlementaires de l'histoire de la Macédoine.
Bref rappel des événements de 2001
L'année 2001 a été marquée en Macédoine par de violents affrontements entre les forces gouvernementales de Skopje et la guérilla albanaise de l'Armée de libération nationale (dont l'acronyme, UCK -Ustria Clirimtare Kombetäre- est identique à celui de l'Armée de libération du Kosovo officiellement démantelée en 1999) qui était parvenue à contrôler le nord et le nord-ouest du pays. Après sept mois de conflit ayant entraîné l'exode de plus de 800 000 personnes et en présence de Javier Solana, Haut responsable de l'Union européenne pour la politique étrangère, et de George Robertson, secrétaire général de l'OTAN, les quatre principaux partis macédoniens et albanophones, membres depuis juin d'un gouvernement d'union nationale (il s'agit d'une part du VMRO -Parti démocratique pour l'unité nationale macédonienne- et du SDSM -Union social démocrate de Macédoine- côté macédonien et, d'autre part, du PDA- Parti démocratique albanais- et PPD -Parti de la prospérité démocratique- côté albanais) ont signé sur les bords du lac Ohrid un accord mettant fin aux violences entre les deux communautés. Cet accord portait sur quatre points essentiels :
- la reconnaissance de l'albanais (langue maternelle d'environ un quart de la population macédonienne) comme langue officielle dans les zones où la population albanophone représente au moins 20% de la population ainsi que l'autorisation de l'albanais au Parlement comme dans l'enseignement supérieur et la rédaction des lois en macédonien et en albanais
- le renforcement des pouvoirs locaux de la minorité albanophone et l'augmentation de 23% du nombre de policiers albanophones au sein des forces de l'ordre (ils n'étaient que 3% en août 2001)
- l'amendement de la Constitution en vue d'une reconnaissance de droits élargis à la population albanophone
- le désarmement de la guérilla de l'UCK et l'amnistie des rebelles n'ayant pas commis de crimes susceptibles de relever du Tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie.
L'UCK, absente de la table des négociations, s'est engagée auprès de l'OTAN à respecter ces résolutions et s'est officiellement dissoute après la signature de l'accord. Conformément à celui-ci, l'OTAN a mis en place, le 22 août 2001, une mission d'un mois, baptisée « Moisson essentielle », incluant la présence de 3 500 soldats de l'Alliance atlantique, chargés de collecter les armes de la guérilla. En septembre, un millier d'observateurs civils internationaux ont été déployés sur le territoire macédonien dans le cadre d'une nouvelle mission appelée « Renard Roux ». Celle-ci a depuis été prolongée trois fois et prendra fin le 26 octobre 2002.
L'Union européenne s'est déclarée prête à relever l'organisation transatlantique en Macédoine cet automne mais sa participation reste suspendue à la conclusion d'un accord de coopération logistique avec l'OTAN, accord bloqué depuis un an par la Grèce, insatisfaite des garanties implicites accordées aux Turcs sur la non-intervention de l'Union européenne dans les litiges gréco-turcs en mer Egée et à Chypre. L'intervention d'une force européenne en Macédoine constituerait la première opération militaire commune des Européens.
Le 16 novembre 2001, la Constitution a été modifiée. Quinze nouveaux amendements ont été ajoutés au texte de 1991 stipulant, entre autres, la reconnaissance de l'albanais comme deuxième langue officielle du pays, l'accès de la minorité albanophone aux postes de la fonction publique, la mise en place de mécanismes de blocage lors des votes par le Parlement ou les assemblées locales de lois à caractère culturel, l'élection d'une commission aux relations inter-ethniques comprenant sept Macédoniens, sept albanophones et cinq membres des autres communautés du pays (turcophone, rom, serbe, bosniaque et valaque), la garantie d'une représentation équitable de la composition ethnique du pays au sein du Conseil de sécurité nationale et l'égalité de droits entre l'ensemble des minorités et le « peuple macédonien » majoritaire. Le 24 janvier dernier, le Parlement macédonien a adopté une législation octroyant davantage de droits à la minorité albanophone (renforcement des pouvoirs locaux) et, le 7 mars, la loi d'amnistie a été votée. Par ailleurs, des patrouilles mixtes constituées de Macédoniens et d'albanophones ont été déployées dans les villages où des violences avaient eu lieu. Enfin, le gouvernement a repris le contrôle des zones sensibles, rendant possible la tenue d'élections législatives.
Le système politique macédonien
Les premières élections législatives libres et démocratiques se sont tenues en Macédoine en novembre et décembre 1990. Dix-sept formations politiques y participaient présentant 1 095 candidats parmi lesquels ont été élus les cent-vingt membres de la Sobranie, le Parlement macédonien. Jusqu'à 1998, date des dernières élections législatives, les députés étaient élus pour quatre ans, au scrutin majoritaire à un tour pour quatre-vingt-cinq d'entre eux et à la proportionnelle pour les trente-cinq autres. En 2002, le scrutin sera entièrement proportionnel ; le pays sera divisé en six circonscriptions élisant chacune vingt députés.
Huit formations politiques sont représentées dans l'actuel Parlement :
- le Parti démocratique pour l'unité nationale macédonienne (VMRO-DPMNE), largement majoritaire et situé à droite de l'échiquier politique,
- l'Union social-démocrate de Macédoine (SDSM), principal parti d'opposition du pays
- l'Alternative démocratique, fondé en avril 1998 par Vasil Tupurkovski, allié au VMRO-DPMNE,
- le Parti de la prospérité démocratique (PPD), le plus important des partis albanophones dirigé par Abdurahman Haliti,
- le Parti libéral démocratique (LDP) allié au VMRO-DPMNE,
- le Parti démocratique albanais (PDA), dirigé par Arben Dzhaferi,
- le Parti socialiste macédonien et l'Union des Roms possédant chacun un seul député.
Le 15 septembre, 3 060 candidats issus de trente formations politiques, sept coalitions et cinq associations de citoyens se présenteront devant les électeurs. Dans la perspective du scrutin législatif, le Parlement de Macédoine a été officiellement dissout le 19 juillet dernier. « Le vote est d'une grande importance pour le développement de la démocratie dans notre pays, les élections confirmeront que (...) les citoyens de Macédoine sont décidés et capables de construire un meilleur avenir pour notre pays » déclarait le Président macédonien Boris Trajkovski le 15 août. Chacun, en Macédoine, est effectivement conscient du test crucial que constituent ces élections législatives pour la paix et la démocratie dans ce petit pays des Balkans.
Rappel des résultats des élections législatives des 18 octobre, 1er et 15 novembre 1998:
Participation : 72,9%
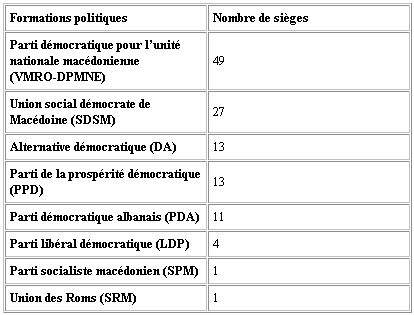 Source : Le Courrier des pays de l'Est, Europe centrale et orientale 2000-2001, Vers l'intégration européenne et régionale, n° 1016, Paris, La Documentation Française, 2001
Source : Le Courrier des pays de l'Est, Europe centrale et orientale 2000-2001, Vers l'intégration européenne et régionale, n° 1016, Paris, La Documentation Française, 2001Pour aller plus loin
Élections en Europe
Corinne Deloy
—
19 janvier 2026
Élections en Europe
Corinne Deloy
—
12 janvier 2026
Élections en Europe
Corinne Deloy
—
3 novembre 2025
Élections en Europe
Corinne Deloy
—
27 octobre 2025

La Lettre
Schuman
L'actualité européenne de la semaine
Unique en son genre, avec ses 200 000 abonnées et ses éditions en 6 langues (français, anglais, allemand, espagnol, polonais et ukrainien), elle apporte jusqu'à vous, depuis 15 ans, un condensé de l'actualité européenne, plus nécessaire aujourd'hui que jamais
Versions :



