Analyse
Actualité
Corinne Deloy,
Francis Luisier
-

Versions disponibles :
FR
EN
Corinne Deloy
Francis Luisier
Le 19 octobre prochain, les Suisses seront appelés à renouveler le Conseil national, Chambre basse du Parlement et une partie (quarante et un des quarante-six membres) du Conseil des Etats, Chambre haute. L'élection des conseillers nationaux a lieu tous les quatre ans l'avant-dernier dimanche d'octobre. L'élection des « conseillers aux Etats » se déroule le même jour dans la majorité des cantons ; cependant, la date et les modalités du scrutin étant régies par le droit cantonal, certains cantons procèdent à l'élection de leurs conseillers aux Etats soit avant (c'est le cas des cantons de Zoug, d'Appenzell-Rhodes-Intérieures et des Grisons), soit après.
Le système politique suisse
Le Parlement suisse est bicaméral.
Le Conseil aux Etats compte quarante-six membres, élus au scrutin majoritaire et répartis à raison de deux sièges pour chacun des vingt cantons suisses et d'un siège pour chacun des six demi cantons (Appenzell-Rhodes-Intérieures, Appenzell-Rhodes-extérieures Bâle-Ville, Bâle-Campagne, Nidwald, Obwald). Leur mandat de quatre ans est reconductible selon les modalités fixées par la législation de chaque canton. Le 19 octobre prochain, quarante et un des quarante-six sièges du Conseil seront renouvelés.
Le Conseil national comprend deux cents conseillers nationaux élus au scrutin proportionnel au sein des Etats de la Confédération helvétique. Les deux cents sièges sont répartis en fonction de la population des cantons. Ainsi, le canton de Zurich élit une quarantaine de conseillers, pesant pour un cinquième du Conseil alors que les plus petits cantons disposent d'un seul siège de conseiller.
Actuellement, treize formations politiques sont représentées au Conseil national :
- l'Union démocratique du centre (UDC), héritière du Parti des paysans, artisans et bourgeois (PAB), a fait son entrée au Conseil fédéral en 1929. Depuis les années quatre vingt dix, cette formation s'est clairement positionnée à droite et a connu une forte progression électorale jusqu'à devenir en 1999 le premier parti du pays en nombre de suffrage obtenus ;
- le Parti socialiste (PS), après une décennie de résultats inférieurs à 20% des suffrages, dispute à l'UDC la première place dans les intentions de vote ;
- le Parti radical démocratique (PRD) a toujours été représenté au Conseil fédéral dont il détenait l'ensemble des sièges jusqu'en 1891. Depuis 1983, il perd régulièrement du terrain lors de chaque scrutin et est arrivée en troisième position lors des dernières élections du 24 octobre 1999. Son groupe parlementaire est toutefois le plus important du Parlement sortant ;
- le Parti démocrate-chrétien (PDC), auparavant appelé Parti catholique conservateur, s'est constitué comme l'organe politique des catholiques suisses. Il a changé de nom au début des années soixante-dix dans une optique de repositionnement au centre. Il a longtemps représenté un cinquième de l'électorat avant de voir, dans les années quatre-vingts, régulièrement chuter les votes en sa faveur ;
- le Parti écologiste suisse-Les Verts (PES) est issu de divers mouvements écologistes qui se sont constitués au sein de plusieurs cantons au cours des années soixante-dix ;
- le Parti libéral suisse (PLS), fondé en 1913 et regroupant l'aile droite des Radicaux, est fortement implanté en Suisse romande ;
- les Démocrates suisses (SD), fondés en 1961 sous le nom d'Action nationale, étaient positionnés sur la lutte contre l'immigration. Rebaptisés Démocrates suisses en 1990, ils ont élargi leur domaine d'action politique ;
- le Parti évangélique suisse (EVP) a pour objectif de mener une politique chrétienne et progressiste ;
- l'Union démocratique fédérale (UDF), fondée en 1975 et particulièrement implantée dans le canton de Berne, prône une ligne politique conservatrice ;
- le Parti suisse du travail-Parti ouvrier populaire (PST), successeur du Parti communiste suisse interdit en 1940, est presque exclusivement implanté en Suisse romande ;
- la Ligue des Tessinois (LdT) est apparue en 1991 comme un mouvement protestataire de droite ;
- Solidarités (Sol), née dans la partie francophone de la Suisse et à Bâle, est un mouvement de gauche radicale ;
- le Parti chrétien social (PCS), héritier du mouvement chrétien social de la fin du XIXème siècle, n'a été officiellement fondé qu'en 1997.
Après les élections du 19 octobre prochain, les deux Chambres se réuniront en Assemblée fédérale. Les deux cent quarante-six membres renouvelleront le gouvernement en élisant tour à tour les sept membres du Conseil fédéral (gouvernement). Actuellement, les sept conseillers fédéraux (équivalent de ministres) sont répartis depuis 1959 selon ce que l'on nomme en Suisse la « formule magique », c'est-à-dire selon leur représentativité politique, l'équilibre des langues étant également respecté. Ainsi, le gouvernement comprend deux conseillers fédéraux du Parti démocrate-chrétien (PDC), deux conseillers fédéraux du Parti radical démocratique (PRD), deux conseillers fédéraux du Parti socialiste (PS) et un conseiller fédéral issu de l'Union démocratique du centre (UDC). Cette composition est inchangée depuis 1959. Au moins six des actuels conseillers fédéraux devraient se représenter ; l'un des conseillers du Parti radical démocrate ayant annoncé sa volonté de quitter le gouvernement. Le gouvernement n'est donc pas l'émanation d'une majorité parlementaire élue sur un programme de gouvernement mais le résultat d'un accord entre les quatre principales formations politiques du pays. Ces formations gouvernent par consensus, sans programme commun ni charte électorale. Les textes législatifs font l'objet d'un compromis entre les partis mais il est fréquent que les formations politiques contestent par voie de référendum certaines des décisions du gouvernement, y compris lorsque leurs représentants au gouvernement les ont approuvées. Les partis peuvent alors faire appel au peuple pour peu qu'ils réunissent cinquante mille signatures sur un projet de référendum dans les cent jours après le vote de la loi. Ces dernières années, les formations de gauche ont eu recours au référendum, principalement pour tenter de mettre un frein à la libéralisation du pays, les formations de droite pour s'opposer à une plus grande ouverture du pays sur le monde. En dépit de ce qui peut apparaître de prime abord, le peuple possède donc en Suisse un réel pouvoir de contrôler l'action du gouvernement et assume finalement en partie le rôle qui revient dans de nombreux pays aux formations de l'opposition.
Si les élections fédérales du 19 octobre ont une importance relative au vu du consensus régissant la vie politique du pays (les abstentionnistes ont d'ailleurs constitué lors des dernières élections fédérales la première force politique de Suisse, des abstentionnistes, cela vaut la peine d'être noté, se déclarant toutefois dans leur majorité satisfaits du système), il est également vrai qu'il existe peu de pays dans lequel les citoyens ont autant d'influence directe sur l'action de leur gouvernement. Les Suisses ont d'ailleurs adopté le 9 février dernier par référendum une proposition qui étend leurs droits d'initiative populaire, permettant à cinquante mille citoyens qui en font la demande de soumettre au scrutin populaire tout traité international nécessitant l'adaptation des lois nationales (jusqu'alors, certains traités internationaux n'étaient pas soumis au vote populaire) et autorisant cent mille personnes à déposer une proposition visant à adopter, modifier ou abroger une loi ou la Constitution.
La fameuse formule magique a été plusieurs fois remise en question. Tout d'abord par le Parti socialiste qui, dans les années quatre-vingts, a souvent affirmé sa volonté de se retirer d'un gouvernement trop dominé par la droite. Invités en 1984 à se prononcer sur cette question lors d'une assemblée extraordinaire, les délégués du Parti socialiste ont finalement décidé par 773 voix contre 511 qu'il était plus bénéfique de rester au sein du gouvernement que d'en être exclu. Aujourd'hui, la remise en cause de la formule magique vient de l'Union démocratique du centre, formation en nette progression électorale depuis 1995. Lors du dernier scrutin général du 24 octobre 1999, l'Union démocratique du centre est devenue le premier parti du pays en recueillant 22,54% des suffrages. La formule magique mise au point en 1959 correspond donc de moins en moins à la réalité politique du pays puisque mathématiquement, l'UDC mériterait aujourd'hui d'obtenir un deuxième siège au gouvernement. A l'inverse, le Parti démocrate-chrétien, en recul depuis quelques années (15,90% des voix au dernier scrutin fédéral), est devenu la plus faible des formations gouvernementales et est donc surreprésenté au sein du Conseil fédéral où il possède deux membres. Cependant, la formule magique ne peut être réduite à une simple formule mathématique, ce système implique également, et surtout, que les différents membres du gouvernement, et donc les différentes formations politiques, parviennent à s'entendre sur une politique commune pour gouverner le pays. Or, l'Union démocratique du centre s'est distinguée ces dernières années par une politique d'opposition systématique au gouvernement en lançant de nombreux référendums contre les décisions de la coalition gouvernementale : contre les accords avec l'Union européenne, contre la création d'une fondation de solidarité financée par les réserves d'or de la Banque nationale suisse, etc. En novembre dernier, un référendum proposant le durcissement du droit d'asile, initié par l'UDC, recueillait ainsi 49,9% des suffrages. Cette politique d'opposition systématique fait craindre à ses partenaires politiques que la première formation politique du pays n'ait ni la volonté, ni la capacité à œuvrer à la recherche du consensus.
La présidence de la Confédération helvétique est tournante, chacun des ministres du gouvernement devenant tour à tour chef de l'Etat pour un an. L'ex-ministre de l'Economie, Pascal Couchepin (PRD), a été élu à cette fonction le 4 décembre 2002 en remplacement du ministre des Finances Kaspar Villiger. Il assure depuis le 1er janvier 2003 et pour un an la Présidence de la Confédération helvétique. Ce même jour, Micheline Calmy-Rey (PS) a été élue au siège laissé vacant par le départ de la ministre de l'Intérieur Ruth Dreifuss (PS). Lors de ce scrutin, le candidat de l'Union démocratique du centre, le député zurichois Toni Bortolozzi, a créé la surprise en recueillant des voix au-delà de sa propre formation.
Les enjeux du scrutin
Comme dans de nombreux pays d'Europe, la vie politique en Suisse est de moins en moins marquée par le clivage gauche-droite mais de plus en plus polarisée sur un nouveau clivage politique, celui opposant d'un côté modernité et ouverture et de l'autre tradition et repli sur soi, un créneau largement occupé par l'Union démocratique du centre, qui a réduit les autres formations à se positionner par rapport à elle. En défendant le service public et les acquis sociaux, le Parti socialiste apparaît comme résistant à la modernité. En conséquence, les intentions de vote finissent par accroître le clivage gauche-droite (PS à gauche et UDC à droite) au détriment du centre (PDC et PRD). Les enquêtes d'opinion montrent l'importance croissante des enjeux politiques concrets dans le vote des citoyens. A la veille du scrutin de 1999, les problèmes de l'asile politique et de l'immigration arrivaient ainsi en tête des préoccupations des citoyens alémaniques, la situation économique et le chômage occupant encore la première place en Suisse romande.
Cette année, les formations politiques s'affrontent sur des thèmes classiques (situation économique, retraites, Europe, libéralisation du système de santé) mais sont également appelées à se positionner sur des sujets comme la sécurité et l'immigration. Les retraites constituent le thème central de la campagne du Parti radical démocratique alors que l'Union démocratique du centre s'est positionnée comme leader de la libéralisation du système de santé. Selon la dernière enquête d'opinion réalisée en septembre dernier par l'institut de recherches politique et sociales de Berne (GfS), les cinq thèmes préoccupant le plus les Suisses sont les finances publiques, la politique d'asile, le coût de la santé, la crise économique et les retraites.
Cette enquête d'opinion révèle également que 52% des Suisses s'apprêtent à se rendre aux urnes le 19 octobre prochain. L'Union démocratique du centre conforte sa place de première formation politique du pays, recueillant 26% des intentions de vote. Le Parti socialiste arrive en deuxième position avec 22% des suffrages, les deux autres partis gouvernementaux obtenant respectivement 20% pour le Parti radical démocratique et 15% pour le Parti démocrate-chrétien. La surprise vient des écologistes qui, pour la première fois, passent la barre des 5%, recueillant 6% des intentions de vote. Parmi les autres formations non gouvernementales, le Parti libéral suisse (PLS) et le Parti évangélique suisse (EVP) obtiennent respectivement 2% des suffrages, les autres partis se situant en dessous de ce chiffre. L'institut GfS a également, lors de sa dernière enquête d'opinion, interrogé les Suisses sur le maintien de la formule magique. Il ressort de ce sondage qu'une grande majorité de la population (80%) souhaite que les quatre principales forces politiques du pays restent représentées au gouvernement. Pour quatre Suisses sur dix, il convient de maintenir la formule magique, un tiers de la population souhaitant un rééquilibrage à droite (un siège supplémentaire pour l'Union démocratique du centre aux dépens du Parti démocrate-chrétien), l'idée d'affaiblir le Parti socialiste n'ayant la faveur que de 15% des personnes interrogées.
2 836 personnes sont officiellement candidates à un siège de conseiller national le 19 octobre prochain, un nombre en recul pour la première fois depuis les années soixante-dix. Les Suisses de l'étranger, qui n'ont obtenu le droit de vote et d'éligibilité que depuis onze ans, présenteront cette année seize candidats. Lors du dernier scrutin général du 24 octobre 1999, seuls deux Suisses de l'étranger s'étaient présentés. Les enquêtes d'opinion montrent combien le vote des Suisses de l'étranger est différent de celui de leurs compatriotes vivant dans la Confédération helvétique. En effet, selon le dernier sondage réalisé par l'institut de recherches politique et sociales de Berne (GfS), 31% d'entre eux s'apprêtent à voter pour le Parti socialiste, 18% pour le Parti radical et 15% pour l'Union démocratique du centre. Par ailleurs, des citoyens naturalisés présentent une liste (Second@s Plus) dans le canton de Zurich. Cette liste, alliée au Parti socialiste, comprend trente-quatre candidats de vingt et une nationalités différentes.
La constitution de la future majorité parlementaire (renforcement ou non des forces conservatrices) et la modification de la formule magique (présence accrue de l'Union démocratique du centre) forment les deux enjeux principaux des élections fédérales suisses du 19 octobre prochain. Si les enquêtes d'opinion sont particulièrement favorables à l'Union démocratique du centre, il reste que les arrondissements jouent en Suisse un rôle important dans la répartition des sièges au Parlement. Par conséquent, la progression attendue de l'Union démocratique du centre pourrait se heurter aux bastions du Parti démocrate chrétien, notamment dans les petits cantons de la Suisse centrale comprenant un nombre de sièges réduit.
Rappel des résultats des élections fédérales au Conseil national du 24 octobre 1999:
Participation : 43,4%
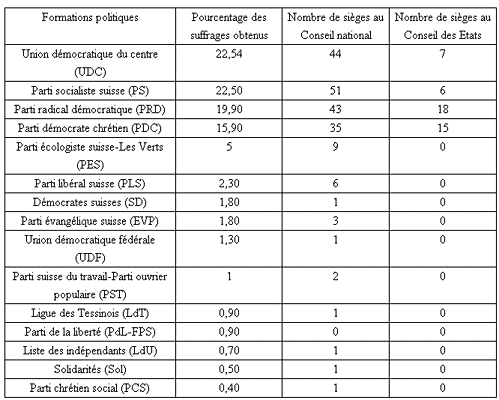 Source Parlement suisse
Source Parlement suisseSur le même thème
Pour aller plus loin
Élections en Europe
Corinne Deloy
—
3 novembre 2025
Élections en Europe
Corinne Deloy
—
27 octobre 2025
Élections en Europe
Corinne Deloy
—
13 octobre 2025
Élections en Europe
Corinne Deloy
—
6 octobre 2025

La Lettre
Schuman
L'actualité européenne de la semaine
Unique en son genre, avec ses 200 000 abonnées et ses éditions en 6 langues (français, anglais, allemand, espagnol, polonais et ukrainien), elle apporte jusqu'à vous, depuis 15 ans, un condensé de l'actualité européenne, plus nécessaire aujourd'hui que jamais
Versions :



