Actualité
Corinne Deloy,
Fondation Robert Schuman
-

Versions disponibles :
FR
EN
Corinne Deloy
Fondation Robert Schuman
Au coeur de la Méditerranée, Chypre est aujourd'hui à la croisée des chemins. Les chefs d'Etat des parties Sud et Nord de l'île divisée depuis 1974, Glafcos Cléridès, Président de la République de Chypre (Sud), et Rauf Denktash, dirigeant de la partie turque (Nord), ont entamé début décembre des négociations directes pour mettre fin à la division du pays autour du plan de paix proposé par les Nations Unies le 11 novembre dernier. L'ONU a donné aux leaders politiques jusqu'au 28 février prochain pour parvenir à un accord, faute de quoi aucune alternative ne pourra être envisagée et la partie Sud de l'île rejoindra seule l'Union européenne. "Le choix réside entre ce plan ... et aucun accord du tout" a déclaré Alvaro de Soto, représentant personnel du secrétaire général des Nations Unies, Kofi Annan, à Chypre. C'est dans ce contexte difficile que les Chypriotes grecs vont élire les 16 et 23 février (second tour éventuel) leur nouveau Président de la République. Une élection capitale, pour l'île comme pour toute l'Europe.
Le plan de paix des Nations Unies
Depuis juillet 1974, Chypre est traversée par une « ligne verte », divisant le pays en deux entités séparées , et contrôlée par les Casques Bleus des Nations Unies. La partie Nord de l'île est occupée par l'armée turque et s'est autoproclamée République turque de Chypre du Nord, une entité que la Turquie est le seul Etat à reconnaître au niveau international. 190 000 Chypriotes y vivent contre 650 000, dont un tiers de réfugiés du Nord, au Sud de l'île. Si Bruxelles ne fait pas du règlement du conflit une condition de l'adhésion de Chypre à l'Union européenne en 2004, la perspective de l'intégration de l'île constitue une réelle opportunité de résoudre enfin un problème désormais quasi trentenaire. Le 11 novembre 2002, l'ONU a proposé aux Chypriotes un plan de paix proposant l'instauration d'un Etat commun sur le modèle de la Confédération helvétique et de deux Etats constituants, un grec et un turc, exerçant chacun tous les pouvoirs que la Constitution ne délègue pas explicitement à l'Etat commun. Celui-ci serait compétent en matière de politique extérieure, politique européenne, économie, monnaie, défense et immigration. Un Président et un vice-Président, l'un grec et l'autre turc, exerceraient le pouvoir à tour de rôle suivant une rotation de dix mois. Le gouvernement serait assuré par un collège de six membres au sein duquel chaque communauté aurait un nombre de sièges proportionnel à son poids démographique. L'île serait démilitarisée et placée sous la protection des forces armées de la Turquie, de la Grèce et du Royaume Uni, ces trois pays étant les garants constitutionnels de l'accord de paix. La présence des Casques Bleus des Nations Unies serait également maintenue. Chaque Chypriote posséderait une double nationalité, celle de l'Etat commun et celle de son entité propre. Enfin, le plan de paix stipule que les Chypriotes turcs contrôleraient 28% de l'île, contre 37% actuellement, ce qui permettrait à environ soixante mille des deux cent mille Chypriotes grecs déplacés lors de l'invasion turque de 1974 de regagner leurs foyers.
Mercredi 15 janvier, les Présidents Glafcos Cléridès et Rauf Denktash se sont rencontrés pour la première fois depuis la publication du plan de paix des Nations Unies. Les discussions doivent se poursuivre jusqu'au 30 mars 2003, date à laquelle les deux communautés de l'île se prononceront par référendum sur ce plan de paix. Deux commissions ont été créées pour rédiger la trentaine de lois qui constitueront la base légale d'une Chypre réunifiée.
Les réactions de la population
La population de l'île est divisée face au plan de paix. Selon les enquêtes d'opinion, la majorité des Chypriotes grecs rejettent la proposition des Nations Unies. 75% déclarent redouter les violences en cas de réunification de l'île et 52% craignent une baisse de leur niveau de vie (la différence de PIB entre les deux parties de l'île est conséquente : 13 000 euros annuels au Sud contre 3 000 au Nord). Nombreux sont également ceux qu'inquiètent la possible naturalisation d'une grande partie des soixante dix mille colons venus d'Anatolie et installés au Nord de l'île depuis 1974. Selon le plan de paix, la moitié d'entre eux pourraient devenir citoyens chypriotes (une présence de sept années dans l'île est requise pour l'obtention de la nationalité), les autres pourraient se voir proposer une compensation financière. Mais surtout, les Chypriotes craignent que les négociations sur la réunification ne finissent par remettre en cause le processus d'adhésion de la partie Sud de l'île à l'Union européenne. « Le plus important pour nous, c'est d'appartenir à l'Union, d'avoir un avenir tracé et sans danger politique » souligne ainsi George Vassiliou, négociateur chypriote à Bruxelles.
Contrairement aux habitants du Sud de l'île, les Chypriotes turcs sont en majorité (88% selon un sondage réalisé en septembre dernier par l'Institut Kadern et 65,4% selon une enquête publiée fin décembre dans le journal Kibris) favorables au plan de paix des Nations Unies, pour des raisons exactement inverses à celles mises en avant par leurs voisins du Sud. Les habitants du Nord de l'île voient en effet dans la réunification la possibilité de sortir du marasme économique dans lequel ils vivent (et de l'embargo international qui les frappe) et la chance de rentrer dans l'Union européenne. En effet, si la Turquie apporte une assistance financière à la partie Nord de l'île, la crise économique frappant le pays n'a pas été sans conséquence pour les Chypriotes turcs. L'Union européenne a d'ailleurs d'ores et déjà annoncé qu'en cas de réunification, elle consacrerait plus de 200 millions d'euros pour aider la partie turque à combler son retard économique.
Depuis fin novembre, les habitants du Nord de l'île multiplient les manifestations, réunissant partis de l'opposition social-démocrate et organisations de la société civile, en faveur du plan de paix des Nations Unies. La dernière en date, la plus grande jamais organisée dans le pays, s'est déroulée le 14 janvier dernier et a réuni environ cinquante mille personnes, soit un quart de la population de cette partie de l'île. Brandissant des drapeaux européens, les Chypriotes turcs se sont rassemblés aux cris de « Denktash démission ». Le Président de la partie Nord de l'île est opposé au plan de paix tel qu'il est rédigé, estimant inacceptable le retour dans le Nord de soixante mille Chypriotes grecs et accusant l'Union européenne de vouloir « posséder Chypre et construire une sorte de forteresse chrétienne autour de la Turquie ». Mais le leader du Nord est en difficulté, Ankara lui ayant laissé entendre qu'elle n'était pas favorable à la politique menée depuis quarante ans dans l'île, Recep Tayyip Erdogan allant jusqu'à déclarer « que le dossier chypriote n'est pas la propriété personnelle de Rauf Denktash ». La Turquie, qui a fait de l'adhésion à l'Union européenne sa priorité, a d'ailleurs décidé une modification de sa politique traditionnelle de soutien inconditionnel vis-à-vis de la République turque de Chypre du Nord. De son côté, la Grèce, qui défend la candidature de la Turquie à l'Union européenne, a su éviter tout triomphalisme sur la question chypriote. L'actuel ministre des Affaires étrangères, George Papandréou, ne perd jamais une occasion de répéter qu'il voit dans la réconciliation franco-allemande au sein de l'Union européenne un modèle pour les futures relations de son pays avec la Turquie. La Grèce assurant jusqu'au 30 juin 2003 la présidence de l'Union, c'est à Athènes que sera signé le 16 avril prochain le traité d'adhésion de Chypre à l'Union européenne.
Le système politique chypriote
La Constitution chypriote de 1960, qui n'est plus appliquée dans l'île depuis les troubles intercommunautaires de 1963, stipule que le Président est également le chef du gouvernement. La fonction de Président est réservée à un Chypriote grec quand celle de vice-Président revient à un Chypriote turc (le poste est actuellement vacant). Selon la Constitution, 30% des sièges du gouvernement et du Parlement sont également réservés aux Chypriotes turcs. L'actuel Président de l'île est Glafcos Cléridès, élu au suffrage universel pour un mandat de cinq ans une première fois le 23 février 1993, avec un écart de mille huit cents voix sur le Président sortant George Vassiliou, et réélu le 15 février 1998. Chef de l'exécutif, le Président chypriote nomme les ministres du gouvernement qu'il dirige.
Glafcos Cléridès, âgé de quatre vingt-trois ans, est le doyen des chefs d'Etat dans le monde. Député et chef du Parlement de 1960 à 1976, il a assumé à ce titre les fonctions de Président par intérim de juillet à décembre 1974, en l'absence de Mgr Makarios, renversé par le coup d'Etat nationaliste qui a provoqué l'invasion par la Turquie de la partie Nord de l'île. Glafcos Cléridès a participé entre 1960 et 1976 à toutes les négociations avec les Chypriotes turcs et ces dernières années, aux pourparlers de paix (1993, 1994, 1997 et 2001) qui n'ont pas permis aucun progrès notable quant à la réunification de l'île. Le Président est membre du Rassemblement démocratique (Disy), formation conservatrice qu'il a fondée en 1976.
Glafcos Cléridès, qui avait annoncé qu'il ne briguerait pas de nouveau mandat, est revenu sur sa décision le 3 janvier dernier en se déclarant candidat à un nouveau mandat présidentiel réduit à seize mois. « Mon devoir devant l'Histoire m'oblige à me confronter à ces défis historiques. Je ne peux pas me permettre de faire autrement » a t-il déclaré pour justifier sa décision, ajoutant « Les développements sont rapides et historiques et détermineront l'avenir de Chypre dans les mois qui viennent. Il nous faudra prendre des décisions majeures. Je resterai aux affaires pendant seize mois avec pour but exclusif de résoudre le problème national (la division de l'île) et d'assurer l'adhésion de Chypre à l'Union européenne ». Le Président sollicite donc un mandat courant jusqu'en mai 2004, date officielle de l'entrée de l'île dans l'Union européenne.
Le 4 janvier, Alekos Markidès (Rassemblement démocratique), procureur général et ancien bras droit de Glafcos Cléridès, a annoncé sa candidature à l'élection présidentielle contre le Président sortant. Le leader du Parti démocratique (Diko) Tassos Papadopoulos sera, quant à lui, le candidat d'une opposition unie. Il est soutenu par les trois formations d'opposition (l'Akel, le Diko et le Kisos (Parti social démocrate)) qui se sont déjà unies avec un certain succès lors des dernières élections locales de décembre 2001. Le maintien de leur candidature par les deux membres du Rassemblement démocratique (Disy) avantagerait considérablement Tassos Papadopoulos, actuel favori de l'élection présidentielle selon toutes les enquêtes d'opinion.
Rappel des résultats de l'élection présidentielle des 8 et 15 février 1998:
Premier tour le 8 février 1998
Participation : 91,72%
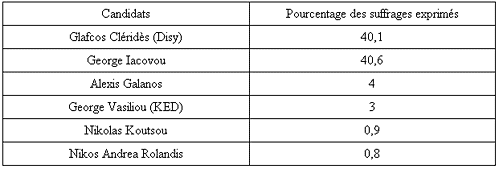 Source Gouvernement chypriote
Source Gouvernement chypriote
Deuxième tour le 15 février 1998
Participation : 93,37%
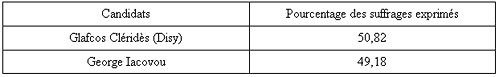 Source Gouvernement chypriote
Source Gouvernement chyprioteSur le même thème
Pour aller plus loin
Élections en Europe
Corinne Deloy
—
3 novembre 2025
Élections en Europe
Corinne Deloy
—
27 octobre 2025
Élections en Europe
Corinne Deloy
—
13 octobre 2025
Élections en Europe
Corinne Deloy
—
6 octobre 2025

La Lettre
Schuman
L'actualité européenne de la semaine
Unique en son genre, avec ses 200 000 abonnées et ses éditions en 6 langues (français, anglais, allemand, espagnol, polonais et ukrainien), elle apporte jusqu'à vous, depuis 15 ans, un condensé de l'actualité européenne, plus nécessaire aujourd'hui que jamais
Versions :



